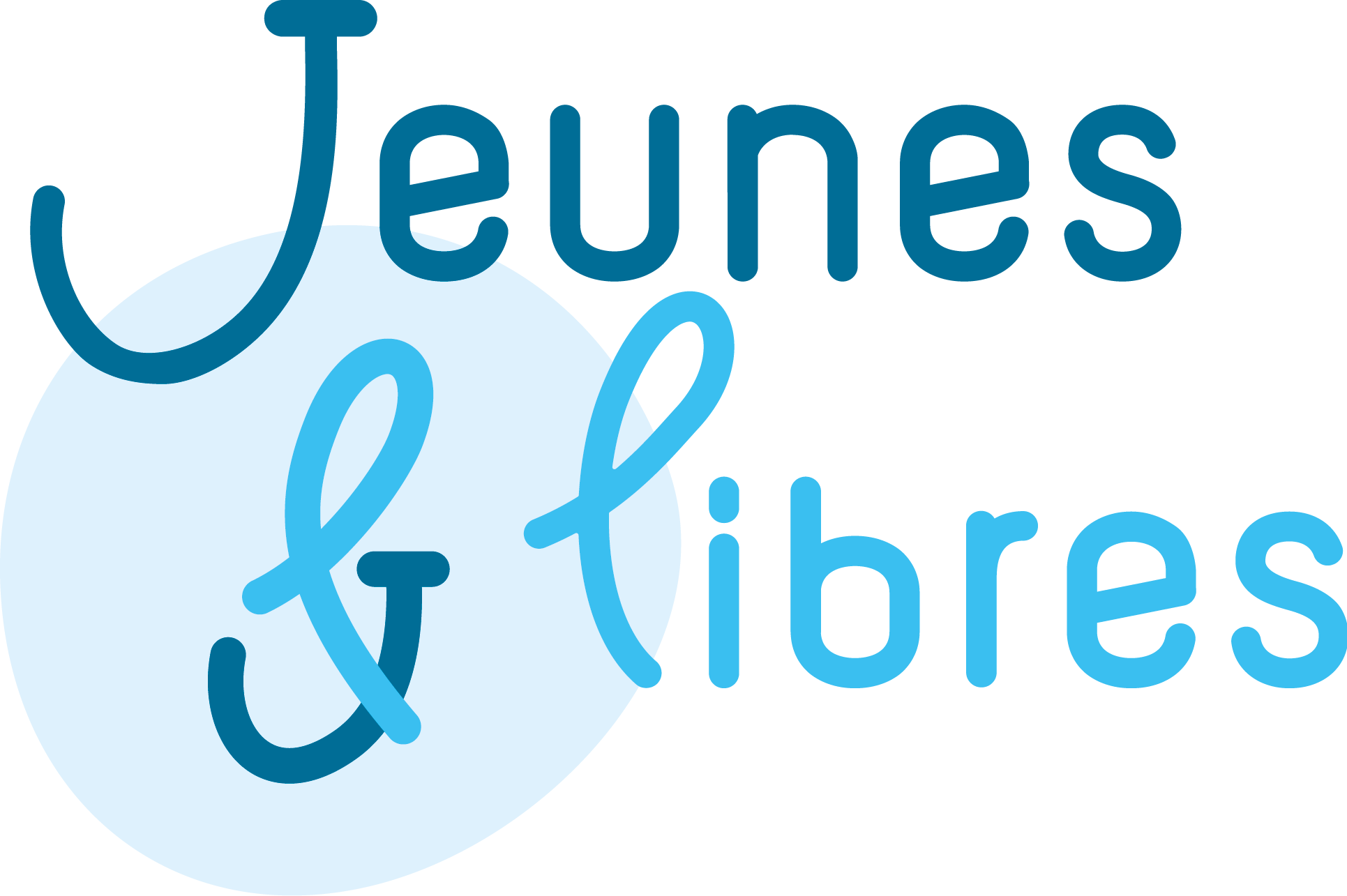Aujourd’hui, les entrepreneurs sont admirés et perçus, à tort ou à raison, comme le modèle de réussite.
Ce numéro du Libre² est dans l’air du temps, on ne compte plus les livres, les sites, les vidéos sur YouTube ou les conférences consacrés à l’entrepreneuriat. Ce thème est devenu une véritable philosophie qui possède son propre langage et ses codes. Mais comment en est-on arrivé là ? Et au fond, qu’est-ce qu’un entrepreneur ? Et pour nous, libéraux, quel rôle a joué la doctrine libérale pour les entrepreneurs d’hier et d’aujourd’hui ?
Prononcez « entrepreneur » dans une conversation et, naturellement, le nom des dirigeants des grandes entreprises de la Silicon Valley sont cités. Les Marck Zuckerberg, Elon Musk ou encore Jeff Bezos fascinent et inspirent ou parfois suscitent le rejet. Ce sentiment se confirme au regard de l’Histoire, car si la notion d’entrepreneuriat a fortement évolué avec le temps, elle reste intimement liée aux personnalités qui l’incarnent.
Petit coup d’œil dans le rétroviseur
Si l’on peut considérer que des entrepreneurs, ou plus exactement des formes d’entrepreneuriats, ont pu exister avant la révolution industrielle, c’est réellement à cette période que le mot « l’entrepreneur » va revêtir le sens qu’on lui connait aujourd’hui. Deux témoins de cette époque seront des pionniers dans leur approche et dans leur tentative de définition de l’entrepreneur : Richard Cantillon (1680-1734), sorte de business angel du XVIIIe siècle et l’économiste Jean-Baptiste Say (1767-1832).
Ces deux auteurs, dont les réflexions sont séparées d’environ un siècle, partagent une partie de leur analyse : ils perçoivent d’abord dans l’entrepreneur un individu prêt à prendre des risques, qui découlent de l’investissement personnel (et bien souvent pécuniaire) qu’il consent en faveur d’une affaire qu’il compte bien faire fleurir.
Si Cantillon s’attarde sur la notion plus capitaliste du terme, pour lui, un entrepreneur achète une matière première, la transforme et la revend dans le but de faire un profit. Say, quant à lui, descelle dans l’entrepreneur celui par qui vient l’innovation en le dissociant de la notion capitalistique sans la nier toutefois. Il n’hésitera pas à soutenir les thèses libérales, les plus propices, selon lui, au développement de l’entrepreneuriat et donc de l’innovation. Nous y reviendrons.
D’autres grands auteurs ont, bien entendu, jeté leur regard sur la figure de l’entrepreneur.
Le père des théories sur
l’innovation, Joseph Schumpeter
(1883-1950), a été le premier à
faire rentrer le terme dans
le domaine public. De façon
cohérente, il lie l’innovation à l’entrepreneuriat. Par ailleurs,
il n’hésite pas à franchir un cap, en mettant en avant le rôle clef que jouent les entrepreneurs dans le développement
économique.
Plus tard, des années ‘50 et jusqu’aux années ‘80, l’entreprise au sens large
deviendra un sujet de fascination. L’entrepreneur est perçu comme un capitaine d’industrie. Les managers deviennent des objets de culte, en particulier, aux Etats-Unis. On ne cesse de louer leurs qualités, et nombreux sont les sociologues et psychologues, comme McCeland et sa Théorie des besoins, qui tentent d’appréhender les aptitudes qui font un bon manager.
L’explosion, dans les années ‘80, des technologies de l’information va contraindre les grandes entreprises à s’adapter rapidement aux changements et défis posés par la révolution numérique. Les managers doivent en permanence réinventer leur entreprise. Ces capacités d’adaptation, d’anticipation et d’innovation sont particulièrement présentes dans l’esprit entrepreneurial. En d’autres termes et de façon schématique, les grandes entreprises doivent raisonner comme les petites et être plus proactives, ne plus rester dans la gestion mais être dans l’action.
L’ère des bits fait la part belle aux entrepreneurs et a ouvert grand la porte aux fameuses start-ups. Les histoires, devenues quasi des légendes, de quelques passionnés d’informatique partis à la conquête du monde de leur garage ou de leur chambre étudiante sont légion. Si la réalité est évidemment plus complexe, il y en a une qui est indéniable : il n’a peut-être jamais été aussi facile pour très peu de personnes de bouleverser et, parfois, de s’emparer de tout un marché. On ne compte plus le nombre de grandes entreprises disparues ou réduites à peau de chagrin, incapables de s’adapter au monde et à leur concurrence numérique.
Si l’entrepreneur a su muer au gré des époques jusqu’à devenir dans notre société actuel presqu’un idéal, il n’en demeure pas moins que cette évolution n’aurait jamais pu se faire
sans l’apport considérable du modèle libéral.
À l’instar de Jean-Baptiste Say, Stuart Mill et Friedrich Hayek, deux illustres penseurs libéraux, se sont penchés sur le rôle moteur que jouent les entrepreneurs dans l’économie et l’innovation. Hayek, pape de la théorie libérale classique, souligne également le rôle d’informateur que joue un entrepreneur vis-à-vis du marché, en y introduisant des innovations.
Ils ne sont pas les seuls. Car si l’entrepreneuriat n’est pas intrinsèquement lié au libéralisme, il est le système qui lui permet de s’épanouir voire d’émerger tout court. Un entrepreneur est en recherche de
liberté afin de développer son entreprise dans le but de s’émanciper souvent lui-même. C’est toujours le libéralisme qui récompense le plus l’effort et la prise de risques, parce qu’il défend toujours l’égalité devant l’impôt plutôt que l’égalitarisme par l’impôt.
En outre, l’entrepreneuriat s’appuie également sur le capitalisme, n’en déplaise à certains esprits chagrins, capitalisme, lui-même, amarré au libéralisme dans une relation complexe. Il serait trop long de l’expliquer ici mais Jean Gol en soulignait à merveille la nécessité car, écrivait-il, le capitalisme pratiqué sans libéralisme conduit à l’injustice voire la servitude. Même le fameux entrepreneuriat social s’épanouit dans un modèle capitaliste et
libéral, tout en mettant l’emphase sur la finalité de l’entreprise.
Le libéralisme associé au capitalisme forme un environnement qui se nourrit de la création de
richesse, elle-même portée par l’innovation. Une forme de cercle vertueux dans lequel les entrepreneurs jouent le rôle de catalyseurs. Il n’est pas étonnant de constater que la dernière génération des entrepreneurs du numérique est principalement issue de pays où la tradition libérale est plus ancrée culturellement.
L’histoire de l’entrepreneuriat s’est forgée grâce à des individus passionnés qui ont mis leurs qualités et leurs compétences au service d’une idée et puis d’une entreprise. Ces entreprises n’auraient jamais pu se développer sans un environnement libéral indispensable. Ces entreprises, par les innovations qu’elles ont apportées, ont changé et continuent à façonner notre société dans tous ses pans.
Pierre Brassinne
Jeunes MR