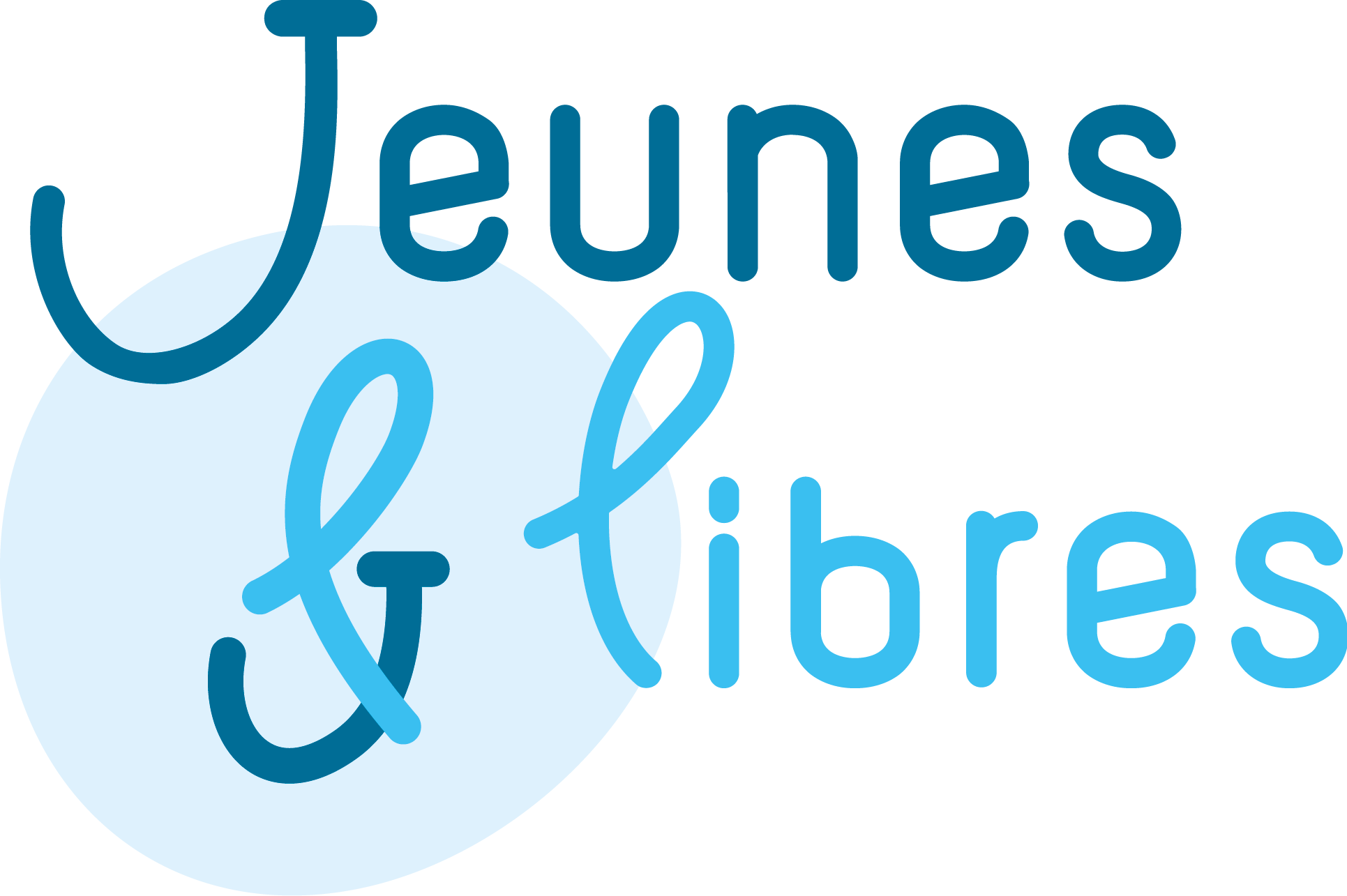C’est dans un lieu rempli de sens, sur le quai de la gare de Bruxelles-Luxembourg qu’Olivier, coordinateur général de ReForm, nous a fixé rendez-vous pour nous parler de son expérience, riche de plus de 20 ans au sein de la structure.
Jeunes & Libres : Pourquoi avoir choisi ce lieu ?
Oliver Crine : J’ai choisi la gare de Bruxelles-Luxembourg parce que je suis un navetteur. J’habite à Namur et tous les jours, je prends le train pour venir travailler à l’antenne régionale de ReForm Bruxelles. De plus, toutes les autres régionales se situent en Wallonie, je m’y rends donc régulièrement, et ce, en train. Et pour conclure, ce lieu est aussi un lieu de culture. Il y a régulièrement des cours de rap dans le hall de la gare, ce qui occupe mon temps lorsque les trains sont en retard. Ça m’impressionne toujours.
J&L : Quel est ton parcours au sein de Reform ? Comment es-tu devenu de coordinateur ?
O. C. : J’ai le bonheur d’avoir exercé quasiment l’ensemble des fonctions dans l’association J’ai débuté comme animateur à Namur pour ensuite devenir le coordinateur de l’antenne. Ensuite, j’ai occupé la coordination de l’ensemble des régionales aux côtés de Bernard Ligot pendant deux ans avant d’accéder à la direction de l’association, depuis quelques années maintenant.
J&L : Peux-tu donner trois mots qui te caractérisent ?
O. C. : Je suis quelqu’un de créatif, d’enthousiaste et souvent de bonne humeur.
J&L : Peux-tu nous dire une chose que les gens ne savent pas sur toi ?
O. C. : Il y a quelques années, j’ai repris des cours du soir dans le but d’obtenir un diplôme en « restauration et salle » que j’ai malheureusement dû abandonner par manque de temps.
J&L : Quelles sont les thématiques sur lesquelles vous travaillez ?
O. C. : Nous travaillons sur deux axes. L’éducation à la culture chez les jeunes qui est, depuis toujours, une de nos priorités et l’axe citoyenneté. Même si cet axe est lié au décret, c’est une thématique que les équipes de ReForm aiment travailler avec les jeunes. Dernièrement, nous avons créé et mis en place un conseil consultatif des enfants à Silly. Nous travaillons également cet axe grâce à nos écoles de devoirs où l’enfant a le droit de s’exprimer, créer des projets en matière d’environnement, de bien-être, etc.
J&L : Quelles sont les valeurs de reform que tu défends ?
O. C. : Dans la cadre du 50ème anniversaire de l’association, nous sommes justement occupés à redéfinir notre charte de valeurs avec les équipes, mais également avec les jeunes qui fréquentent notre service de jeunesse. C’est un travail collectif et je ne souhaite pas avancer sans eux.
Mais je peux déjà vous confirmer que le bien-être est une valeur transversale et qu’elle est importante au sein de notre structure tant pour nos employés que pour les jeunes qui participent à nos activités.
J&L : Peux-tu nous citer un projet qui t’a marqué depuis que tu es coordinateur et ce que tu as pu en retirer ?
O. C. : C’est compliqué pour moi de mettre un seul projet en avant, je vais donc aborder deux axes. Le premier, c’est l’axe « environnemental » et « éducation à l’environnement » qui se traduit par des actions de sensibilisation dans les écoles et la création de stages pendant les vacances scolaires. C’est un projet que j’ai mis en place lorsque j’étais animateur à Namur et qui est toujours développé par mes collègues dans chaque antenne régionale en plus d’être totalement dans l’air du temps. Pour faire le lien, avec un projet orienté vers ces deux axes, il y a deux ans, nous avons créé le « collectif Ruba[r]b ». Nous avons réalisé des œuvres d’art à partir de sacs en plastique afin de sensibiliser à la pollution des océans. Grâce à ce projet, nous sommes partis avec une dizaine de jeunes au Canada pour y rencontrer d’autres
artistes. Ce projet a également abouti sur plusieurs expositions, dont une à Bruxelles, qui a marqué l’empreinte de ReForm en matière de sensibilisation environnementale.
J&L : Qu’est-ce que c’est, pour toi, gérer une asbl ?
O. C. : J’ai le sentiment qu’au fur et à mesure que les années passent, la gestion d’une asbl se complexifie. C’était plus facile il y a 20 ans. Les contraintes administratives sont beaucoup plus importantes même si elles sont justifiées. Aujourd’hui, la gestion de ReForm prend quasiment la totalité de mon temps.
J&L : Quelle est la qualité principale pour être coordinateur d’une association ?
O. C. : Être créatif et à l’écoute de son équipe me semblent être les deux qualités principales.
J&L : Comment t’es-tu formé au métier de manager ?
O. C. : Je me suis formé sur le tas. J’ai suivi quelques formations sur le management quand j’ai été nommé directeur, mais j’ai surtout été à l’écoute des équipes et je le suis toujours.
Avec le conseil d’administration, nous souhaitons que ReForm soit et reste une grande famille où l’on se sent bien. D’ailleurs, la majeure partie de l’équipe a plus de quinze ans d’ancienneté.
J&L : Peux-tu présenter la structure de reform ?
O. C. : L’asbl est composée de dix-sept employés répartis dans cinq régions différentes. Le siège social est situé à Bruxelles. Nous sommes six employés dont trois personnes qui s’occupent de l’administratif et trois animatrices qui elles, sont régulièrement sur le terrain et s’occupent de notre local de création qui se situe dans le quartier Matonge. Les autres antennes sont à Nivelles, Namur, Silly et Verviers. Chaque antenne régionale est dirigée actuellement par une coordinatrice-animatrice avec qui j’échange régulièrement et qui est également membre du comité de direction comprenant le personnel administratif et les coordinatrices des différentes antennes. Nous avons aussi énormément de volontaires, étudiants ou bénévoles qui font un travail de terrain remarquable aux côté de nos équipes.
J&L : Quel est ton rôle au sein de la structure ?
O. C. : Mon rôle est multiple. J’ai un rôle « administratif », un rôle de « manager », et ce, au quotidien avec les différentes équipes et un rôle de « rencontres » avec les partenaires culturels et associatifs. J’ai aussi pour mission d’impulser des projets et des nouvelles idées. Pour terminer, c’est un rôle « fédérateur » autour de ce que l’on appelle, dans le secteur, le plan quadriennal. Je veille à ce que toutes nos actions soient en lien avec ce que nous avons prévu et développé dans ce plan.
J&L : Peux-tu me parler des relations entre les différentes antennes ?
O. C. : Les différentes antennes collaborent régulièrement sur des projets communs comme les séjours à la mer ou dans les Ardennes. Nous organisons aussi des journées de formation, des moments de rencontre et chaque année nous avons une mise au vert.
J&L : Quelles sont les contraintes auxquelles tu fais face au quotidien ?
O. C. : Comme chaque directeur d’association, nous faisons face à une lourdeur administrative. La rédaction des appels à projets et des subventions est fastidieuse.
Ensuite, chez ReForm, nous avons une équipe qui a, en moyenne, quinze ans d’ancienneté. C’est une équipe soudée, disponible et efficace, c’est notre force, mais malheureusement, cela a un coût. Je pense que les pouvoirs publics doivent être à l’écoute et se rendre compte de cette particularité.
J&L : Quels sont les défis à venir au sein de votre OJ ?
O. C. : Le premier défi est l’organisation des 50 ans de l’association. Nous souhaitons mobiliser l’équipe et les jeunes autour d’un projet fédérateur qui va pouvoir mettre en avant l’asbl. Le deuxième défi est la rédaction du prochain plan quadriennal. Nous sommes actuellement dans une période d’évaluation, de réflexion et je pense que 2023 sera la période idéale pour pouvoir, avec les jeunes et nos équipes, écrire et penser ce que sera l’association entre 2024 et 2028.
J&L : Est-ce que, selon toi, le coordinateur est le gardien des engagements décrétaux de l’OJ ?
O. C. : Sans aucun doute ! C’est le coordinateur avec l’aide du conseil d’administration qui doit tenir la ligne directrice de l’association, que ce soit par rapport aux obligations liées au plan quadriennal, mais aussi par rapport à l’ensemble des appels à projets qui sont réalisés.
J&L : Comment organises-tu, projettes-tu ton management ?
O. C. : Mes attitudes au quotidien peuvent laisser penser que j’ai une vision à court terme, mais ce n’est pas le cas. Je suis quelqu’un qui réfléchit et pense beaucoup, et ce, tout au long de la journée, lors de mes trajets en train et durant mes soirées. J’aime beaucoup me projeter et projeter ce que sera l’association dans quelques années. Réfléchir à la façon d’améliorer les choses pour garantir le bien-être de mes équipes et l’axe jeunesse de l’association.
J&L : Comment est-ce que tu gères le quotidien ? Présente-nous une journée type ?
O. C. : Il n’y a pas de journée type, mais elles commencent toutes au moins par un coup de téléphone d’un membre de mon équipe pour discuter d’un projet ou autres. Ensuite, je prends le train pour me rendre à Bruxelles. Une fois sur place, je prends le temps de discuter avec mes collègues puis j’ouvre ma boite mail et la journée commence. Mes journées sont rythmées par les différents dossiers à gérer, les tâches administratives et la gestion du personnel.
J&L : Comment géres-tu la multitude d’appels à projets ?
O. C. : Nous gérons très bien la multitude des appels à projets. Comme évoqué tout à l’heure, les équipes sont en place depuis des années ce qui facilite la prise en main et la rédaction de ceux-ci. Elles peuvent travailler en totale autonomie et en général, chaque antenne souhaite rendre un appel à projets. Nous devons donc limiter les demandes ou les coordonner entre les différentes antennes régionales.
J&L : Quel est ton rapport avec la fédération ?
O. C. : Nos liens avec la fédération sont excellents et se sont renforcés depuis quelques années. Nous avons la grande chance d’avoir une fédération qui est à notre écoute, à notre disposition et qui nous aide au quotidien. La taille de la fédération est une force qui permet au coordinateur, mais aussi à l’équipe, d’être proche des associations qui y sont fédérées. Bravo et merci à l’équipe de Jeunes et Libres.
J&L : Peux-tu nous parler des relations avec les autres OJ de Jeunes & Libres ?
O. C. : Historiquement, nous avons peu de liens avec les autres OJ, mais les bons rapports avec la fédération permettent aujourd’hui d’envisager des projets communs. Par exemple, nous travaillons sur un projet avec Délipro Jeunesse et la Besace. Je suis régulièrement en contact avec mes homologues. Nous sommes un peu plus éloignés des réalités politiques, même si des lieux d’échanges existent. Nous ne sommes pas fermés, nous pourrions aussi développer des projets avec la FEL, avec les Jeunes MR ou avec les Jeunes Mutualistes Libéraux.
J&L : Bientôt les 50 ans de ReForm, peux-tu me parler de cet anniversaire ?
O. C. : Je peux déjà vous confirmer que l’anniversaire de ReForm se passera dans un grand lieu de la culture bruxelloise. Ce sera un moment convivial qui reflétera l’activité de l’association.
En plus se grefferont d’autres actions en Fédération Wallonie-Bruxelles en lien avec le théâtre jeune public, le cirque, la danse … Ce sera vraiment la part belle à nos métiers, mais également, la part belle à la culture.
J&L : Quel est ta relation avec le conseil d’administration ?
O. C. : J’ai d’abord le grand bonheur d’avoir un président qui est disponible 24 heures sur 24 avec qui j’échange au quotidien sur les lignes directrices de l’association. J’ai un lien très fort avec lui, mais aussi avec les autres membres de l’équipe du conseil d’administration. Nous sommes régulièrement en contact pour développer des projets et échanger des conseils. Il est important pour moi de développer une confiance et une collaboration avec eux.
Propos recueillis par Pauline Bettonville